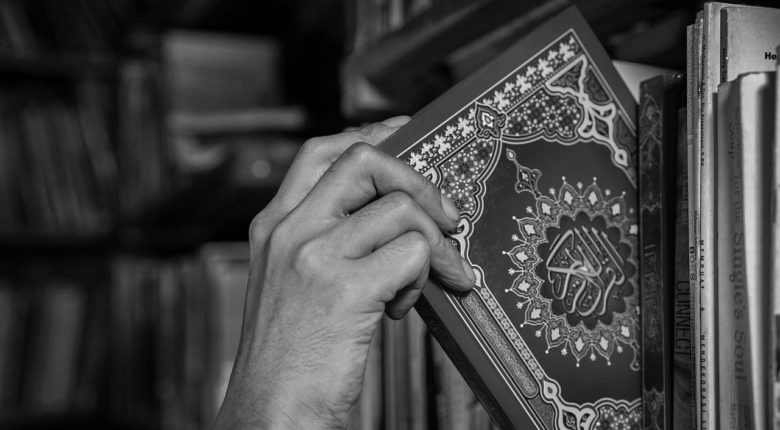
La dhimmitude pour les Nuls
Actu J. 23 octobre 2025
S’il est un terme polémique en islamologie, c’est celui de dhimmitude, que Gisèle Littman, alias Bat Yeor, a popularisé dans son livre de 1991, Les chrétientés d’Orient entre Djihad et dhimmitude. Pour les disciples de Louis Massignon, longtemps pape des études musulmanes en France, ce mot suffit à disqualifier son auteur, immédiatement placé dans l’extrême droite la plus rance. Le non-spécialiste que je suis cherche à sortir de l’impasse des invectives en suivant le fil historique de ce mot.
Si dhimmitude sent le soufre, le terme de dhimmi est bien connu. La dhimma est un pacte entre un non-musulman monothéiste, protégé sous réserve du paiement d’un impôt spécifique, la jaziya, et de l’acceptation de sa subordination à l’Islam.
Le mot dhimma apparait dans la neuvième sourate du Coran, dite at-Tawba (le repentir), chronologiquement l’une des dernières et donc des plus «définitives», car le principe de Naskh issu du Coran lui-même, considère que la vérité est révélée de façon progressivement plus exacte, le nouveau remplaçant l’ancien. Dhimma ne vise ici ni les chrétiens ni les Juifs mais les alliés de Mahomet («les hypocrites») qui n’avaient pas respecté leur pacte lors de son expédition contre les Byzantins (sa dernière campagne). On est là dans un cadre de relations d’alliances entre égaux (ou plus souvent inégaux) communes aux sociétés tribales, et dont la « brit» abrahamlque comme le «foedus» romain (dont la violation est une «perfidia») sont d’autres expressions.
Dans la même sourate, le verset 29 enjoint aux «Gens du Livre» de verser l’impôt «en état d’humiliation» . C’est cette pratique qui a pris le nom de dhimma depuis qu’elle a été systématisée par un calife omeyyade nommé Omar (différent du célèbre troisième calife): c’est le pacte d’Omar. Resté valide pendant près de 12 siècles, il fut modifié suivant les lieux, les époques et les hommes et ce que devait être l’état d’humiliation («ṣāghirūn») a été interprété de façon très variable.
De nos jours, pour les chantres d’un Islam de justice, la dhimma était presque toujours une structure de protection. Pour le grand historien Bernard Lewis, l’homme qui a le premier parlé de choc des civilisations et qui donc n’est pas suspect d’islamo-complaisance, la dhimma impliquait infériorité mais rarement oppression. Pour Bat Yeor c’était une structure de servitude. Elle a été très critiquée, mais les documents qu’elle a produits confirment que la situation fut souvent moins rose qu’on ne l’a pensé, sans même prendre en compte les régimes violemment oppresseurs, comme celui des Almohades.
Entre 1839 et 1878, l’Empire turc édicta des textes qui établirent officiellement l’égalité entre les religions.C’est la période des réformes, les Tanzimat. Elles n’apportèrent pas immédiatement les améliorations économiques que les admirateurs de l’Occident avaient espérées et alimentèrent très vite un. profond ressentiment devant l’humiliation infligée à l’Islam mis au rang des autres religions.
Des intellectuels quittèrent le camp de la réforme occidentale pour glorifier la supériorité de l’Islam. Ce fut le cas de Rashid Rida dont Hassan el Banna, fondateur des Frères Musulmans, fut le disciple. L’idée d’un Islam dominant de droit les autres religions monothéistes, qui fut déjà au cœur de la dhimma, est aujourd’hui l’obstacle dirimant à un dialogue sain sous l’égide d’une laïcité partagée.
L’égalité religieuse n’est en Occident un concept pertinent que depuis peu de temps. En Islam la dhimmitude était un statut et est devenue un comportement adapté. Se demander dans quelle mesure elle devient aujourd’hui en Occident un comportement préadapté avant même d’être un statut est une question provocatrice, mais qui ne doit pas être balayée.
Dr. Richard PRASQUIER
